|
Interview d'
Abed Azrié réalisée par Isabelle Jacq ‘Gamboena’
en février
2009, pour Musique Alhambra
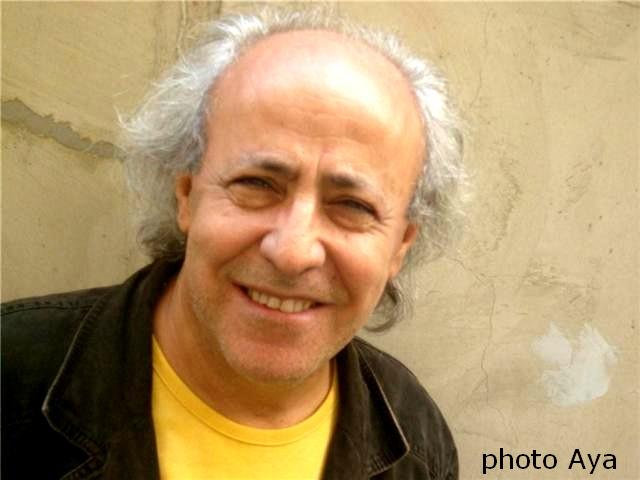
Abed Azrié
La première fois que j'ai écouté un album
d'Abed Azrié, j'étais adolescente. C'était dans un
magasin de musique et j'avais été attirée par la beauté du
portrait photographique d'Abed, sur la pochette de l'album
intitulé 'Les soufis'. En l'écoutant, j'étais fascinée par
sa voix et par l'univers dans lequel il nous faisait
pénétrer. Depuis cette période, j'écoute régulièrement ses
albums car j'aime les textes qu'il interprète, sa
musique, sa voix apaisante et qui donne le 'pellizco'. Ma rencontre avec Abed a donc
beaucoup d'importance et c'est au mois de février
qu'elle a eu lieu:
- Abed Azrié, vous menez
une brillante carrière artistique depuis plusieurs années,
carrière ponctuée de création d’albums. Qu’est ce qui motive
chaque nouveau projet que vous faites?
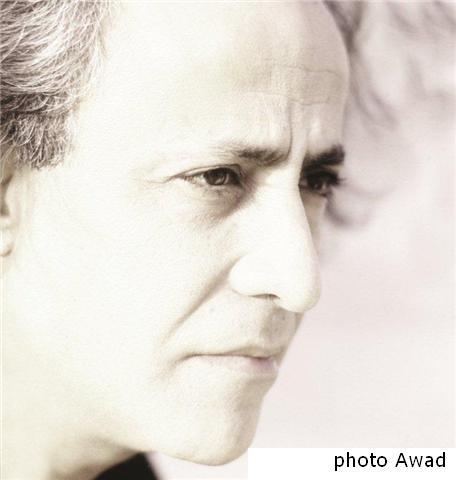 - Tous mes disques sont basés sur des thèmes
essentiels provenant de textes fondateurs qui étaient à
l’origine de la culture méditerranéenne, de notre façon de
penser et de vivre aujourd’hui. Tous ces vieux textes ne
sont pas si anciens que ça ! Ils sont en réalité des
archétypes « modernes » qui, à un moment de l’histoire de
l’humanité, ont été fixés mais provenant à l’origine des
traditions orales millénaires. Dans ce sens, dès que les
Sumériens inventèrent en Mésopotamie l’écriture, c’est à
dire « l’histoire », il y a environ 5000 ans, ils
commencèrent à fixer les traditions orales et les mythes qui
remontaient à l’aube du temps. Le texte « l’épopée de
Gilgamesh », que j’ai adapté, était un de mes premiers
grands travaux, J’ai eu besoin de plusieurs années pour lire
de plus près multiple versions de ce texte et de son
environnement mythologique afin de réaliser un livret et le
mettre par la suite en musique. Il m’a fallu lire tous les
textes Suméro-babyloniens : des mythes sur la création, le
déluge, les cycles sur la fertilité et de l’agriculture, la
justice, l’amour et même des textes juridiques... Le
prochain projet musical s’intitule « L’évangile selon
Jean ». Ce texte comme celui de « Gilgamesh » est un des
textes fondateurs de notre civilisation d’aujourd’hui. Vous
voyez, j’ai toujours travaillé sur un thème et ce thème
devient un gros chantier qu’il faut toujours travailler et
élaborer. Il faut enquêter sur l’époque, la pensée du texte,
comprendre et sentir le plus possible avant de l’exprimer en
chant et musique. - Tous mes disques sont basés sur des thèmes
essentiels provenant de textes fondateurs qui étaient à
l’origine de la culture méditerranéenne, de notre façon de
penser et de vivre aujourd’hui. Tous ces vieux textes ne
sont pas si anciens que ça ! Ils sont en réalité des
archétypes « modernes » qui, à un moment de l’histoire de
l’humanité, ont été fixés mais provenant à l’origine des
traditions orales millénaires. Dans ce sens, dès que les
Sumériens inventèrent en Mésopotamie l’écriture, c’est à
dire « l’histoire », il y a environ 5000 ans, ils
commencèrent à fixer les traditions orales et les mythes qui
remontaient à l’aube du temps. Le texte « l’épopée de
Gilgamesh », que j’ai adapté, était un de mes premiers
grands travaux, J’ai eu besoin de plusieurs années pour lire
de plus près multiple versions de ce texte et de son
environnement mythologique afin de réaliser un livret et le
mettre par la suite en musique. Il m’a fallu lire tous les
textes Suméro-babyloniens : des mythes sur la création, le
déluge, les cycles sur la fertilité et de l’agriculture, la
justice, l’amour et même des textes juridiques... Le
prochain projet musical s’intitule « L’évangile selon
Jean ». Ce texte comme celui de « Gilgamesh » est un des
textes fondateurs de notre civilisation d’aujourd’hui. Vous
voyez, j’ai toujours travaillé sur un thème et ce thème
devient un gros chantier qu’il faut toujours travailler et
élaborer. Il faut enquêter sur l’époque, la pensée du texte,
comprendre et sentir le plus possible avant de l’exprimer en
chant et musique.
- Votre
carrière de chanteur, comment s’est-elle décidée ?
- Je chante depuis que je suis né. Je le
sais, car ma mère me l’a rappelé. Mes frères et sœurs me
l’ont rappelé aussi. Quand j’avais trois ans, je tapotais
sur tous les objets et, au lieu de manger, je tapais sur la
table à manger durant le repas. Cette habitude ne convenait
apparemment pas beaucoup ma mère car à force de ne pas
manger, on me trouvait bien maigre. A l’école, à partir de
l’âge de 8 ans, on devait servir la messe le matin à 7
heures avant les cours. Durant la messe, nous chantions
beaucoup et nous apprenions par cœur les chants en syriaque
(araméen), une des dernières langues sémitiques vivantes
parlées par le christ. On s’habillait à l’ancienne pour
chanter la liturgie. Je devais participer aussi aux grandes
cérémonies et fêtes religieuses comme soliste car j’avais
une voix bien aiguë. Plus tard, à partir de 14 ans, je me
suis brouillé définitivement avec l’église et les
ecclésiastes. Par contre, j’ai continué à assister aux
différentes manifestations et messes de rites différents
parce qu’en Syrie il y a encore une douzaine de communautés
chrétiennes. J’allais aussi souvent assister aux
célébrations et fêtes islamiques car ma mère, bien que
chrétienne, adorait ces fêtes. Elle m’amenait toujours
assister aux séances du « zikr » et de « Mouled », la
naissance du prophète, ces répertoires de chant sacré.
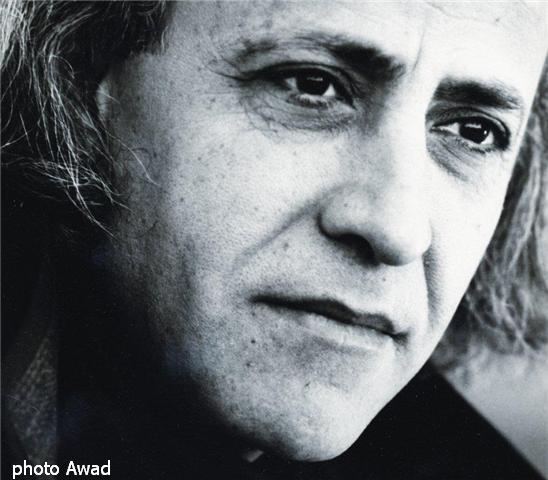 Alep, la ville où je suis née, était une
ville très conservatrice dans tout point de vue, et cela
m’étouffait. Mais une chose positive : ce qu’on apprenait
dans cette ville venait de loin, tout est classique, pur et
rigoureux. Dans mon enfance j’ai écouté beaucoup de
liturgie, du fait que je n’aimais pas les chansons arabes à
la mode. Cela m’a aidé d’abord à affiner et multiplier mon
oreille. Très tôt, j’achetais des 45 tours de musique
cubaine, j’adorais cette musique. Je me procurais ces 45
tours des grands orchestres cubains qui étaient à Miami. Perez Prado ,
Xavier Cugat , tous ces instruments, ces
rythmes chauds m’enthousiasmaient vraiment. J’écoutais aussi
des émissions radiophoniques méditerranéennes. J’ai
découvert le Flamenco, très tôt. Quand j’étais adolescent,
j’ai écouté un disque que je n’ai jamais oublié : des
chansons de Lorca jouées par deux guitares, Ramon de
Algesiras et Paco de Lucia. J’ai commencé à apprendre la
musique et le chant en écoutant les liturgies d’Orient à
Alep et en écoutant des musiques qui venaient d’ailleurs,
cubaines, italiennes, françaises… variété internationale,
jazz… Ma venue à Paris, vers l’âge de 19 ans a orienté
définitivement le choix de mes écoutes, et de ma
sensibilité. En arrivant à Paris, j’ai eu un très grand choc
en écoutant pour la première fois « La passion selon Saint
Mathieu » de Bach et le « Requiem » de Mozart. J’ai dû
passer 6 ans à écouter ces deux musiques tout en
découvrant « Iberia » d’Albéniz, « Goyescas », « Canciones
amatotias » et « Tonadillas », de Granados et d’autres… Je
me nourrissais de plus en plus de Bach et des Espagnols. A
partir de ce temps, j’ai commencé à faire ma vraie formation
musicale car Paris m’a donné l’occasion d’écouter tout ce
que je ne connaissais pas et que j’avais envie d’écouter.
C’est ainsi que j’ai formé mon oreille personnelle et ma
voix surtout en écoutant les « autres », certains
« autres ». Alep, la ville où je suis née, était une
ville très conservatrice dans tout point de vue, et cela
m’étouffait. Mais une chose positive : ce qu’on apprenait
dans cette ville venait de loin, tout est classique, pur et
rigoureux. Dans mon enfance j’ai écouté beaucoup de
liturgie, du fait que je n’aimais pas les chansons arabes à
la mode. Cela m’a aidé d’abord à affiner et multiplier mon
oreille. Très tôt, j’achetais des 45 tours de musique
cubaine, j’adorais cette musique. Je me procurais ces 45
tours des grands orchestres cubains qui étaient à Miami. Perez Prado ,
Xavier Cugat , tous ces instruments, ces
rythmes chauds m’enthousiasmaient vraiment. J’écoutais aussi
des émissions radiophoniques méditerranéennes. J’ai
découvert le Flamenco, très tôt. Quand j’étais adolescent,
j’ai écouté un disque que je n’ai jamais oublié : des
chansons de Lorca jouées par deux guitares, Ramon de
Algesiras et Paco de Lucia. J’ai commencé à apprendre la
musique et le chant en écoutant les liturgies d’Orient à
Alep et en écoutant des musiques qui venaient d’ailleurs,
cubaines, italiennes, françaises… variété internationale,
jazz… Ma venue à Paris, vers l’âge de 19 ans a orienté
définitivement le choix de mes écoutes, et de ma
sensibilité. En arrivant à Paris, j’ai eu un très grand choc
en écoutant pour la première fois « La passion selon Saint
Mathieu » de Bach et le « Requiem » de Mozart. J’ai dû
passer 6 ans à écouter ces deux musiques tout en
découvrant « Iberia » d’Albéniz, « Goyescas », « Canciones
amatotias » et « Tonadillas », de Granados et d’autres… Je
me nourrissais de plus en plus de Bach et des Espagnols. A
partir de ce temps, j’ai commencé à faire ma vraie formation
musicale car Paris m’a donné l’occasion d’écouter tout ce
que je ne connaissais pas et que j’avais envie d’écouter.
C’est ainsi que j’ai formé mon oreille personnelle et ma
voix surtout en écoutant les « autres », certains
« autres ».
- Votre voix,
l’avez vous travaillé ou est-elle innée ?
- Je suis comme les gitans et les
flamenquistes, je ne travaille jamais ma voix. En fait, je
chante tout le temps dans ma tête, en travaillant ou en
déambulant dans les rues, même durant un vol d’avion. Je
révise toujours, je corrige, je revois, mais je n’aime pas
trop répéter, je n’aime pas user les notes et fixer la voix,
je n’aime pas fixer la musique ! Quand nous répétons, c’est
pour bien mettre en place les choses, mais la musique n’est
jamais définitive pour moi. Par exemple, il y a eu trois
versions de l’album « Suerte ». La musique est toujours en
évolution ; elle n’est jamais terminée. Une chose est
certaine, quand je suis sur scène, je trouve une voix, une
énergie que je n’ai pas dans la vie courante. Quand je
répète, j’ai une voix neutre, mais dès que je mets mes pieds
sur la scène, j’ai une voix qui est chargée, bien
différente... C’est comme par magie, je deviens un autre !
D’ailleurs dans le livret du disque intitulé « Suerte »,
j’emprunte un texte de Lorca qui en parle merveilleusement.
Quand j’ai le « Duende », je me sens imbattable.
Quand j’entre sur scène, il y a comme une sorte
d’ensorcellement, Je me transforme ! Cela me rappelle des
extraits que j’avais vus sur Pepe Pinto, le mari de la
Niña de los Peines, chanteuse que Lorca admirait
beaucoup. Quand Pepe Pinto ouvrait sa bouche, il devenait un
autre personnage, tout petit qu’il était, il prenait de
l’espace, il nous fait rentrer dans son espace.
- Vous
travaillez en France depuis 1967. Entre la France et vous,
est-ce une histoire d’amour ?
 - Oui, une très grande histoire d’amour et de
complicité… C’est le pays qui a su m’adopter, c’est mon pays
de choix. Je suis né comme tout le monde, quelque part,
sans le vouloir bien que c’était un petit bonheur de vivre
mon enfance auprès d’une mère comme la mienne qui m’a donné
une immense tendresse pour la vie et m’a beaucoup apporté,
je lui dois tout. Alep est une ville un peu aride, une
ville qui a beaucoup de traditions et, pour un adolescent,
c’était difficile à vivre. Tout mon rêve était de quitter
ce pays et je l’ai fait. Quand j’ai vu Paris le premier
jour, j’ai compris que j’étais dans mon élément. La France
est un pays où l’on conteste les choses, on remet sans cesse
tout en question : la voie y est plurielle. J’ai toujours
aimé penser en pluriel. La pensée de l’Orient est
théocratique, totalitaire. Ces pays sont marqués gravement
même maladivement par la religion et le monothéisme en
particulier. Les trois religions monothéistes ont été
magnifiques dans leurs époques, mais aujourd’hui elles sont
destructrices et dangereuses. Ces pays ne se relèveront
jamais s’ils vivent la religion de cette manière. Il faut
absolument qu’ils séparent la religion de leur vie, en
sauvegardant la spiritualité. J’aime ces religions avec leur
dimension spirituelle. Remarquez, si vous enlevez la
spiritualité de l’histoire de l’humanité, il ne reste que
très peu de peinture, de musique... Bach et Monteverdi
pratiquaient la religion mais ils n’ont jamais tué personne
ni fait de la guerre. Ils ont fait de la musique, ils ont
donné aux autres, alors que les conquérants, les croisades,
ils ont tué. Je n’aime pas la violence et les horreurs que
les guerres idéologiques génèrent et engendrent. - Oui, une très grande histoire d’amour et de
complicité… C’est le pays qui a su m’adopter, c’est mon pays
de choix. Je suis né comme tout le monde, quelque part,
sans le vouloir bien que c’était un petit bonheur de vivre
mon enfance auprès d’une mère comme la mienne qui m’a donné
une immense tendresse pour la vie et m’a beaucoup apporté,
je lui dois tout. Alep est une ville un peu aride, une
ville qui a beaucoup de traditions et, pour un adolescent,
c’était difficile à vivre. Tout mon rêve était de quitter
ce pays et je l’ai fait. Quand j’ai vu Paris le premier
jour, j’ai compris que j’étais dans mon élément. La France
est un pays où l’on conteste les choses, on remet sans cesse
tout en question : la voie y est plurielle. J’ai toujours
aimé penser en pluriel. La pensée de l’Orient est
théocratique, totalitaire. Ces pays sont marqués gravement
même maladivement par la religion et le monothéisme en
particulier. Les trois religions monothéistes ont été
magnifiques dans leurs époques, mais aujourd’hui elles sont
destructrices et dangereuses. Ces pays ne se relèveront
jamais s’ils vivent la religion de cette manière. Il faut
absolument qu’ils séparent la religion de leur vie, en
sauvegardant la spiritualité. J’aime ces religions avec leur
dimension spirituelle. Remarquez, si vous enlevez la
spiritualité de l’histoire de l’humanité, il ne reste que
très peu de peinture, de musique... Bach et Monteverdi
pratiquaient la religion mais ils n’ont jamais tué personne
ni fait de la guerre. Ils ont fait de la musique, ils ont
donné aux autres, alors que les conquérants, les croisades,
ils ont tué. Je n’aime pas la violence et les horreurs que
les guerres idéologiques génèrent et engendrent.
- Dans votre album
intitulé’ Gilgamesh', vous ressuscitez la légende sumérienne
de Gilgamesh. Pourquoi ce retour aux sources ?
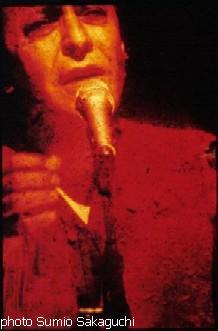 - Je ne crois pas que ce soit un retour aux
sources. Je crois, que ce soit en Orient, en Occident, en
Asie ou en Afrique, le monde a toujours été dominé par un
empire, actuellement, c’est l’empire occidental. C’est ancré
à tel point que les gens ne savent plus qui sont-ils ? Et,
plus on avance, plus on est dans une perte de « sens »
extraordinaire. Nous sommes dans une période où les gens ont
perdu le « sens » des choses. Quand je parle de
spiritualité, je veux dire ce qui nous donne une matière
certaine et cette matière est d’une certaine façon contenue
dans les textes « anciens », fondateurs. Gilgamesh est un
dissident qui s’est révolté contre les dieux car ils font
mourir les hommes après les avoir créés. J’ai toujours été
fasciné et intéressé par l’histoire de rébellion, par ces
gens qui veulent questionner la vie, la raison d’être sur
cette terre. Pour notre bonheur, chercher et trouver des
réponses aux choses. Ces textes anciens ne sont pas si
anciens. Ce sont des aventures humaines hors du temps, des
quêtes que j’aime théâtraliser à travers des notes pour les
partager avec les autres et je pense que, quoi que je fasse,
j’ai tendance à transformer tout ce que je touche en chant.
Même si je prenais un bout de pain et un bout de bois j’en
ferais un chant. Je suis plus un homme de chant, que de
musique. - Je ne crois pas que ce soit un retour aux
sources. Je crois, que ce soit en Orient, en Occident, en
Asie ou en Afrique, le monde a toujours été dominé par un
empire, actuellement, c’est l’empire occidental. C’est ancré
à tel point que les gens ne savent plus qui sont-ils ? Et,
plus on avance, plus on est dans une perte de « sens »
extraordinaire. Nous sommes dans une période où les gens ont
perdu le « sens » des choses. Quand je parle de
spiritualité, je veux dire ce qui nous donne une matière
certaine et cette matière est d’une certaine façon contenue
dans les textes « anciens », fondateurs. Gilgamesh est un
dissident qui s’est révolté contre les dieux car ils font
mourir les hommes après les avoir créés. J’ai toujours été
fasciné et intéressé par l’histoire de rébellion, par ces
gens qui veulent questionner la vie, la raison d’être sur
cette terre. Pour notre bonheur, chercher et trouver des
réponses aux choses. Ces textes anciens ne sont pas si
anciens. Ce sont des aventures humaines hors du temps, des
quêtes que j’aime théâtraliser à travers des notes pour les
partager avec les autres et je pense que, quoi que je fasse,
j’ai tendance à transformer tout ce que je touche en chant.
Même si je prenais un bout de pain et un bout de bois j’en
ferais un chant. Je suis plus un homme de chant, que de
musique.
- La poésie habite aussi
vos œuvres. Quels sont les poètes dont vous vous sentez le
plus proche ?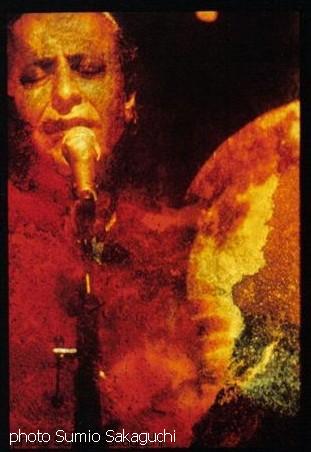
- Je travaille sur des auteurs de différentes
périodes. Cela peut être des auteurs contemporains comme des
auteurs du 19ème siècle. Ce sont des auteurs qui
ont essayé de se révolter contre la condition humaine,
contre quelque chose et ont mené un combat. Je ne suis pas
un homme politique, je ne suis ni de gauche ni de droite,
mais ce combat je le respecte, je respecte l’effort humain.
Mon combat est ailleurs : c’est une quête de vivre, une
quête pour comprendre le mystère de la vie, le mystère de
l’autre, comprendre d’où l’on vient et où l’on va. Je suis
fasciné par certains auteurs qui me bouleversent par leur
sincérité et qui peuvent aussi être chantés. Par exemple,
j’ai fait un double album en 1985 qui s’intitule « Le chant
de l’arbre Oriental ». Dans cet enregistrement, je n’ai mis
que des auteurs contemporains (une dizaine). Si vous suivez
bien les textes, ils racontent une histoire. J’ai choisi des
auteurs qui sont à la recherche d’une esthétique, une
esthétique qui à des racines humaines, physiques,
biologiques. J’essaye de faire au mieux mon travail et c’est
ma façon de respecter les autres.
- Vous
rencontrez le Flamenco et les musiques espagnoles dans
l’album « Suerte », n’est-ce pas ?
- Cela s’est passé bien avant…je suis un
amoureux des musiques espagnoles (comme disait le poète
Antonio Machado : il n’y a pas d’Espagne, mais des Espagnes).
J’adore le Flamenco, la Sévillane.... L’art du flamenco est
profond et dra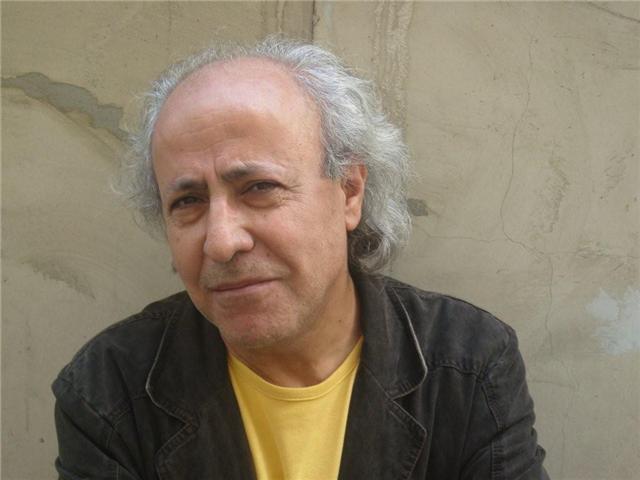 matique alors que la Sévillane, est joyeuse et
dansante. J’aime ces deux aspects. L’Espagne a toujours été
reconnue pour sa peinture, sa littérature, son théâtre, et
ses compositeurs. L’Espagne, c’est la méditerranée et il y a
une grande histoire entre le moyen Orient et l’Espagne.
C’est de Damas que sont partis les Omeyyades et nous ont
laissé comme témoin Cordoue, Grenade et Séville. Quand je
suis allé à Cordoue, il y a quelques années et entré dans la
mosquée de cette ville, je me suis assis parterre. Quelle
architecture, quel art ! Ce lieu me parle mystérieusement et
je ne me ressens ni syrien, ni espagnol. Quand je suis avec
mes musiciens, ce sont eux mes concitoyens et nous sommes
dans un pays de musique. Pour moi, la musique est mon vrai
pays. Ceci dit, il y a quand même des résonnances, quand je
suis en Espagne. La nuit même où j’étais à Cordoue, je suis
allé à un Festival Flamenco et j’ai écouté le chanteur
Terremoto de Jerez, venu de Grenade. Nous étions dans une
salle plus de 1000 places; à un moment donné il s’est levé,
il a quitté le micro et s’est mis à chanter en s’éloignant
de plus en plus presque en dansant. C’était tellement
beau…il était habité. Le Flamenco me bouleverse. Je ne peux
pas écouter facilement un disque de Flamenco. Si je mets un
disque de Flamenco, j’arrête tout et cela devient une
cérémonie. Je rentre à ce moment là dans un combat. Il y a
la mort, la vie. Quand on écoute du Flamenco avec Enrique Morente
par exemple, il faut mettre sa vie sur table,
comme un joueur, sinon on ne peut pas l’écouter. On est dans
un engagement total dans le Flamenco. Voilà, cette histoire
avec la musique espagnole est beaucoup plus ancienne que la
création de l’album « Suerte ». matique alors que la Sévillane, est joyeuse et
dansante. J’aime ces deux aspects. L’Espagne a toujours été
reconnue pour sa peinture, sa littérature, son théâtre, et
ses compositeurs. L’Espagne, c’est la méditerranée et il y a
une grande histoire entre le moyen Orient et l’Espagne.
C’est de Damas que sont partis les Omeyyades et nous ont
laissé comme témoin Cordoue, Grenade et Séville. Quand je
suis allé à Cordoue, il y a quelques années et entré dans la
mosquée de cette ville, je me suis assis parterre. Quelle
architecture, quel art ! Ce lieu me parle mystérieusement et
je ne me ressens ni syrien, ni espagnol. Quand je suis avec
mes musiciens, ce sont eux mes concitoyens et nous sommes
dans un pays de musique. Pour moi, la musique est mon vrai
pays. Ceci dit, il y a quand même des résonnances, quand je
suis en Espagne. La nuit même où j’étais à Cordoue, je suis
allé à un Festival Flamenco et j’ai écouté le chanteur
Terremoto de Jerez, venu de Grenade. Nous étions dans une
salle plus de 1000 places; à un moment donné il s’est levé,
il a quitté le micro et s’est mis à chanter en s’éloignant
de plus en plus presque en dansant. C’était tellement
beau…il était habité. Le Flamenco me bouleverse. Je ne peux
pas écouter facilement un disque de Flamenco. Si je mets un
disque de Flamenco, j’arrête tout et cela devient une
cérémonie. Je rentre à ce moment là dans un combat. Il y a
la mort, la vie. Quand on écoute du Flamenco avec Enrique Morente
par exemple, il faut mettre sa vie sur table,
comme un joueur, sinon on ne peut pas l’écouter. On est dans
un engagement total dans le Flamenco. Voilà, cette histoire
avec la musique espagnole est beaucoup plus ancienne que la
création de l’album « Suerte ».
- Comment avez-vous conçu
l’album « Suerte » ainsi que les différentes versions qui
l’ont succédé?
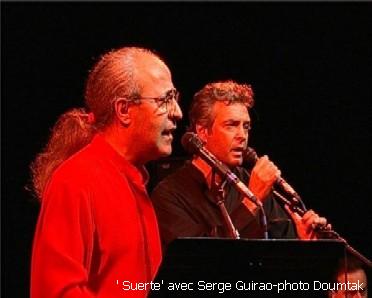 - A partir des années 1982, une idée m’a
prise de faire un travail avec la langue espagnole et la
langue arabe. Je suis tombé sur un livre de manuscrit arabe
d’auteurs né en Espagne à l’époque andalouse. L’auteur,
Emilio Garcia Gomez, grand orientaliste espagnol, son livre
s’intitulait « Las Jarchas romances ». L’ouvrage contenait
des petits trésors de « Mouwash’shahat-s », Ce terme, qui
évoque en arabe « une mantille brodée symétriquement de
perles et de bijoux dont la femme se pare », est une poésie
au style simple, transparent, spontané et raffiné, née en
Andalousie vers la fin du
ixe
siècle. L’orientaliste Emilio Garcia Gomez transcrit les
textes originaux en vocalise, en latin. Alors j’ai dû tout
retranscrire en arabe et à partir de cette étape, j’ai
trouvé l’équivalent traduit en Espagnol. J’ai monté par la
suite une histoire musicale. J’ai construit une histoire
d’amour, d’après ces « Mouwash’shahat-s », en 9 chants et
chaque chant devait contenir un extrait de « las Jarchas »,
ou de plusieurs. Ces chants je les ai faits pour deux voix,
puis j’ai commencé à composer la musique. Lorsque la musique
pour les deux voix fut aboutie, j’ai fait une première
version en studio. Les musiciens n’arrivaient pas à jouer
ensemble. Par exemple, les Espagnols avaient un - A partir des années 1982, une idée m’a
prise de faire un travail avec la langue espagnole et la
langue arabe. Je suis tombé sur un livre de manuscrit arabe
d’auteurs né en Espagne à l’époque andalouse. L’auteur,
Emilio Garcia Gomez, grand orientaliste espagnol, son livre
s’intitulait « Las Jarchas romances ». L’ouvrage contenait
des petits trésors de « Mouwash’shahat-s », Ce terme, qui
évoque en arabe « une mantille brodée symétriquement de
perles et de bijoux dont la femme se pare », est une poésie
au style simple, transparent, spontané et raffiné, née en
Andalousie vers la fin du
ixe
siècle. L’orientaliste Emilio Garcia Gomez transcrit les
textes originaux en vocalise, en latin. Alors j’ai dû tout
retranscrire en arabe et à partir de cette étape, j’ai
trouvé l’équivalent traduit en Espagnol. J’ai monté par la
suite une histoire musicale. J’ai construit une histoire
d’amour, d’après ces « Mouwash’shahat-s », en 9 chants et
chaque chant devait contenir un extrait de « las Jarchas »,
ou de plusieurs. Ces chants je les ai faits pour deux voix,
puis j’ai commencé à composer la musique. Lorsque la musique
pour les deux voix fut aboutie, j’ai fait une première
version en studio. Les musiciens n’arrivaient pas à jouer
ensemble. Par exemple, les Espagnols avaient un
 décompte qui
n’est pas le même que celui des français ou des orientaux.
Chacun avait ses repaires, sa façon de jouer la musique. Ils
n’avaient pas la même technique ni les mêmes références. Je
me suis aperçu qu’il fallait se connaître de plus près, que
les musiciens doivent vivre et jouer ensemble pendant un
certain temps car c’est une histoire humaine avant d’être
une histoire musicale. Nous avons quand même enregistré le
disque en studio et quand il est sorti, bien que ce soit un
album de qualité, je n’étais pas entièrement satisfait du
résultat. C’est par des truchements techniques que nous
avons pu le réaliser. Par la suite, en 1997, j’ai été
contacté par un ami merveilleux, Christian Grenet qui
nous a proposé de réaliser une création au théâtre de « la Mounède » à Toulouse, un lieu situé dans un quartier
défavorisé. Nous avons fait une résidence avec les musiciens
pendant 8 jours d’abord à Paris avec Serge Guirao com décompte qui
n’est pas le même que celui des français ou des orientaux.
Chacun avait ses repaires, sa façon de jouer la musique. Ils
n’avaient pas la même technique ni les mêmes références. Je
me suis aperçu qu’il fallait se connaître de plus près, que
les musiciens doivent vivre et jouer ensemble pendant un
certain temps car c’est une histoire humaine avant d’être
une histoire musicale. Nous avons quand même enregistré le
disque en studio et quand il est sorti, bien que ce soit un
album de qualité, je n’étais pas entièrement satisfait du
résultat. C’est par des truchements techniques que nous
avons pu le réaliser. Par la suite, en 1997, j’ai été
contacté par un ami merveilleux, Christian Grenet qui
nous a proposé de réaliser une création au théâtre de « la Mounède » à Toulouse, un lieu situé dans un quartier
défavorisé. Nous avons fait une résidence avec les musiciens
pendant 8 jours d’abord à Paris avec Serge Guirao com me
chanteur. Puis nous avons répété 12 jours à Toulouse et
quand nous sommes arrivés sur scène, tout a fonctionné
parfaitement. Chacun jouait à partir de sa musique :
L’espagnol restait espagnol, le français restait français et
l’oriental restait oriental. Personne n’a fait de concession
à personne, nous nous sommes tous bien compris. Ce fût une
histoire musicale véritable et je suis réellement heureux de
cette expérience et de cette réalisation qui a donné le CD
« Suerte live ». Nous avons donné des concerts pendant 2 ans
et demi et avons fait une quarantaine de dates avec ce
spectacle. En 2004, j’étais invité par le Festival de
Beyrouth pour donner « Suerte ». Serge Guirao, pour des
raisons de santé, ne pouvait plus y participer. Des amis
m’ont mis en contact avec une cantatrice, Ana Felip, qui a
été emballée tout de suite par le projet. Nous sommes allés
à Beyrouth où nous avons réalisé un DVD de ce spectacle.
Puis nous avons fait un deuxième récital en Allemagne, à
Wuppertal. L’année suivante, nous avons donné un concert à
Berlin en 2006 produit par la fondation
Villa Aurora à l’occasion
de l’autodafé et nous avons réalisé un CD/DVD intitulé: « Suerte
live in Berlin », un concert bien intense. me
chanteur. Puis nous avons répété 12 jours à Toulouse et
quand nous sommes arrivés sur scène, tout a fonctionné
parfaitement. Chacun jouait à partir de sa musique :
L’espagnol restait espagnol, le français restait français et
l’oriental restait oriental. Personne n’a fait de concession
à personne, nous nous sommes tous bien compris. Ce fût une
histoire musicale véritable et je suis réellement heureux de
cette expérience et de cette réalisation qui a donné le CD
« Suerte live ». Nous avons donné des concerts pendant 2 ans
et demi et avons fait une quarantaine de dates avec ce
spectacle. En 2004, j’étais invité par le Festival de
Beyrouth pour donner « Suerte ». Serge Guirao, pour des
raisons de santé, ne pouvait plus y participer. Des amis
m’ont mis en contact avec une cantatrice, Ana Felip, qui a
été emballée tout de suite par le projet. Nous sommes allés
à Beyrouth où nous avons réalisé un DVD de ce spectacle.
Puis nous avons fait un deuxième récital en Allemagne, à
Wuppertal. L’année suivante, nous avons donné un concert à
Berlin en 2006 produit par la fondation
Villa Aurora à l’occasion
de l’autodafé et nous avons réalisé un CD/DVD intitulé: « Suerte
live in Berlin », un concert bien intense.
- Quel est
votre lien avec l’Espagne et l’Andalousie en particulier ?
- A l’origine, j’ai été tellement passionné
par l’histoire de l’Andalousie, c’est à dire du pays
ibérique d’autrefois, de l’époque de Cordoue et de sa poésie
fraîche, de l’architecture de Grenade et de Séville …
Ensuite, j’ai été touché par toutes les musiques du temps
d’Alphonse le sage. Evidemment, l’important dans tout cela,
c’est aussi le Flamenco. J’ai été nourri de disques de
Flamenco dont un de Camaron et Tomatito « Flamenco vivo » où
le guitariste Tomatito apparaît plus important que
l’orchestre symphonique de Londres qui accompagne Camaron
dans son disque suivant « Soy Gitano ». Tomatito est plus
puissant qu’un orchestre symphonique car, dans le Flamenco,
il est question du « Duende » mais pas dans l’accompagnement
symphonique. Pourtant j’ai besoin d’écouter Bach très
souvent. L’auteur Cioran dit à ce propos: « Dieu doit la
religion a Bach » et nous, c’est à Bach que nous devons sans
doute la musique, et à l’Andalousie, l’esprit du « Duende »
- Quels sont vos
projets ?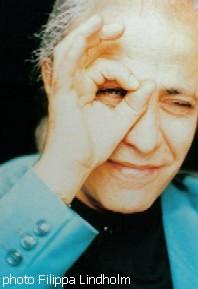
- Plusieurs, comme d’habitude… Nous allons
donner « L’évangile selon Jean », non pas la passion mais le
texte intégral, début juin 2009. C’est un projet que j’ai
commencé à écrire en 1982, au lendemain de la disparition de
ma mère sous forme d’oratorio -chanté en arabe- pour chœur,
soliste et choristes, orchestre occidental et un ensemble de
musique de chambre oriental. L’Arabe est une langue qui va
très bien avec ce projet car c’est la dernière langue
vivante sémitique parlée par beaucoup de gens et qui descend
de l’araméen, langue parlée par le Christ. Nous allons
donner ce spectacle au festival de Fès, le 4 juin, puis à
l’Opéra de Marseille, le 7 juin ; le 9 juin nous serons à
Toulon et le 13, à Nice. D’autre part, au mois de novembre
2009, j’entreprends la création d’un projet qui remonte à
1977 « L’épopée de Gilgamesh » sous forme de spectacle
audio-visuel. Nous allons le donner à l’Institut du Monde
Arabe, à Paris, le 12, 13, 14 novembre 2009, puis nous
ferons une petite tournée en Allemagne. J’ai aussi un projet
d’écriture, pour fin 2010. C’est un projet de Tango avec des
musiciens argentins. Voilà les projets qui sont déjà bien
avancés…
- Merci Abed,
et à très bientôt…

|